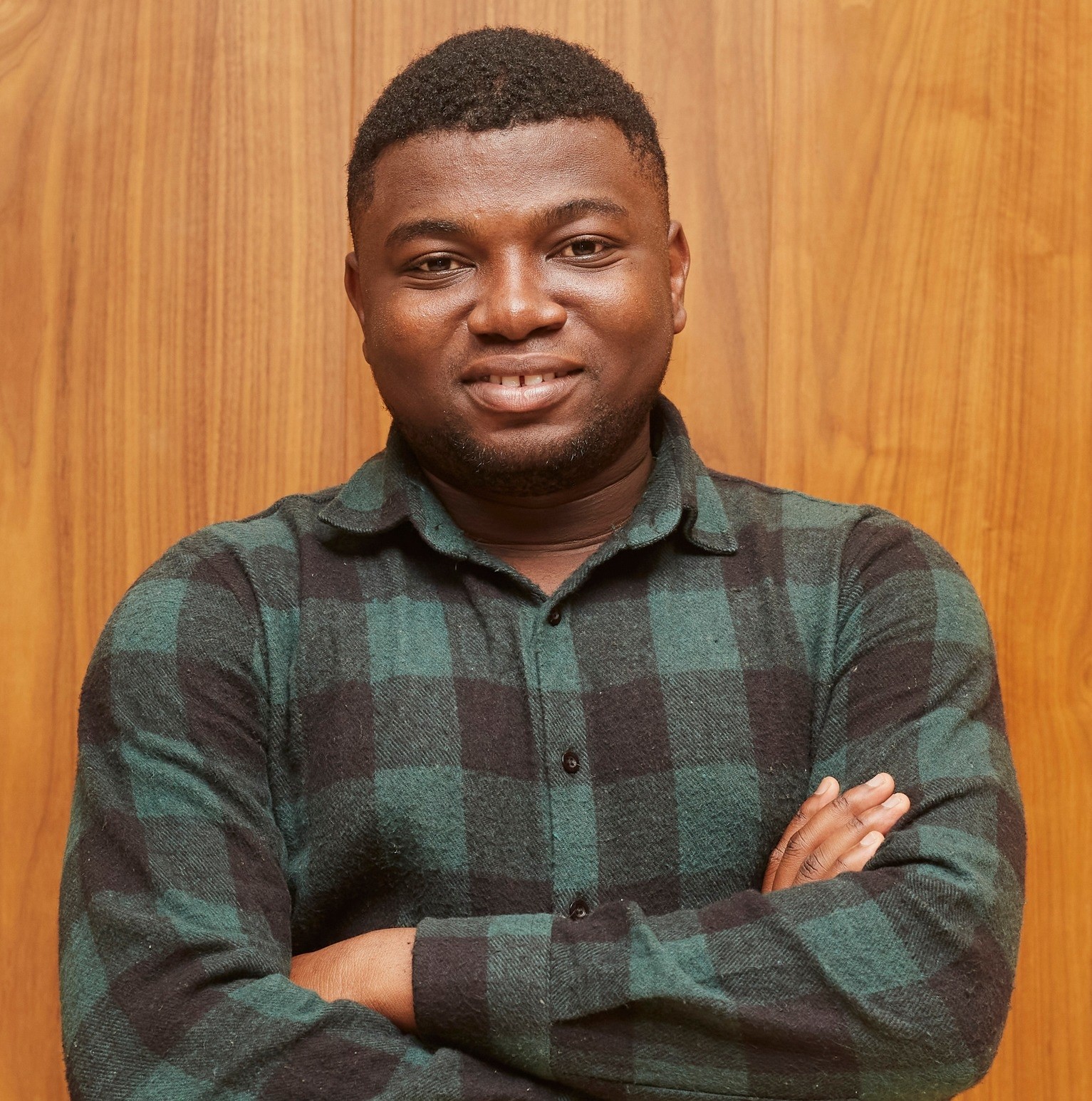Dans le contexte de la révolution en cours en Afrique, il est facile de pointer du doigt les injustices exercées par des forces externes qui pillent nos ressources. Une réalité indéniable. Pourtant, crier “Ooh, voleur !” n’empêche pas le voleur de fuir, ni d’autres de revenir faire la même chose.
Mais dans un monde capitaliste, comment lancer de grands projets de transformation en éducation, santé, agriculture et autres secteurs sans posséder ce fameux capital financier ? Cette question est cruciale. Faute d’alternatives, de nombreux dirigeants se tournent vers des prêts auprès d’institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Ces financements, bien que pouvant être exploités pour transformer nos pays lorsqu’une vision existe, viennent avec des conditions strictes, parfois contraignantes, et influencent nos politiques économiques.
Ce recours aux prêts entraîne souvent l’émergence d’une minorité excessivement riche – une oligarchie pour certains –, qui contrôle une part importante du capital national. À travers ce groupe, une accumulation de richesses permet de naviguer dans les rouages du monde capitaliste. Une fois cet écosystème en place, il devient possible d’utiliser ce capital détenu par des nationaux pour motiver les ressources humaines et impulser des projets de transformation.
Mais le développement structurel repose-t-il uniquement sur ces emprunts ? Non. D’autres stratégies existent. Toutefois, la clé réside dans un changement de paradigme : passer d’une pensée centrée sur l’argent à une pensée axée sur la création de valeur au sein des populations. Cette transition est un défi immense, car elle requiert une transformation culturelle, psychologique et systémique.
Comment aider les communautés africaines à s’affranchir de l’idée que l’argent est le seul moteur du développement ?
Comment les amener à se concentrer sur leurs connaissances, compétences et pouvoir collectif pour bâtir une prospérité durable ?
Plutôt que de rester dans la théorie, je vais présenter une stratégie concrète basée sur le pouvoir collectif et les modèles communautaires. Mais avant cela, un peu d’histoire.
Depuis 2013, j’ai été impliqué dans un projet inspiré par cette philosophie. Malgré une conception solide et une approche fondée sur la collaboration et la création de valeur, ce projet n’a pas connu une accélération fulgurante. Pourtant, aujourd’hui encore, je salue le travail de Zimé Sacca, qui continue d’y croire et de nous fédérer autour de cette vision.
Une Stratégie Basée sur la Banque du Temps et le Partage des Compétences
L’un des modèles communautaires les plus prometteurs est celui de la Banque du Temps et du Partage des Compétences.
Prenons l’exemple de l’éducation. L’Afrique regorge de ressources humaines ; ce qui manque, c’est un mécanisme pour les transformer en agents actifs du monde capitaliste. L’éducation de qualité est la clé. Pourtant, par manque de financement, elle reste inaccessible à une grande partie de la population. De plus, certains soulignent que le financement externe de l’éducation ne profite pas nécessairement au continent.
Dans un modèle de Banque du Temps, au lieu de dépendre uniquement de l’argent, les individus échangent du temps et des compétences. Par exemple, des enseignants ou des professionnels peuvent offrir des cours gratuits en échange de services fournis par les parents d’élèves. Ce modèle favorise une économie du partage, renforce la solidarité locale et réduit la dépendance aux financements extérieurs.
Vers un Changement Psychologique et Collectif
Une approche basée sur la Banque du Temps peut-elle transformer la psychologie collective et encourager un développement plus autonome ?
L’enjeu est de prouver que la valeur ne se limite pas à l’argent. L’Afrique dispose déjà de talents, de savoirs et d’un capital humain inestimable. Il s’agit maintenant de structurer ces atouts et de changer notre manière de penser pour bâtir un avenir fondé sur la coopération et la création de valeur locale.
Qu’en pensez-vous ? Une telle stratégie pourrait-elle être un levier puissant pour notre transformation collective ? 🚀