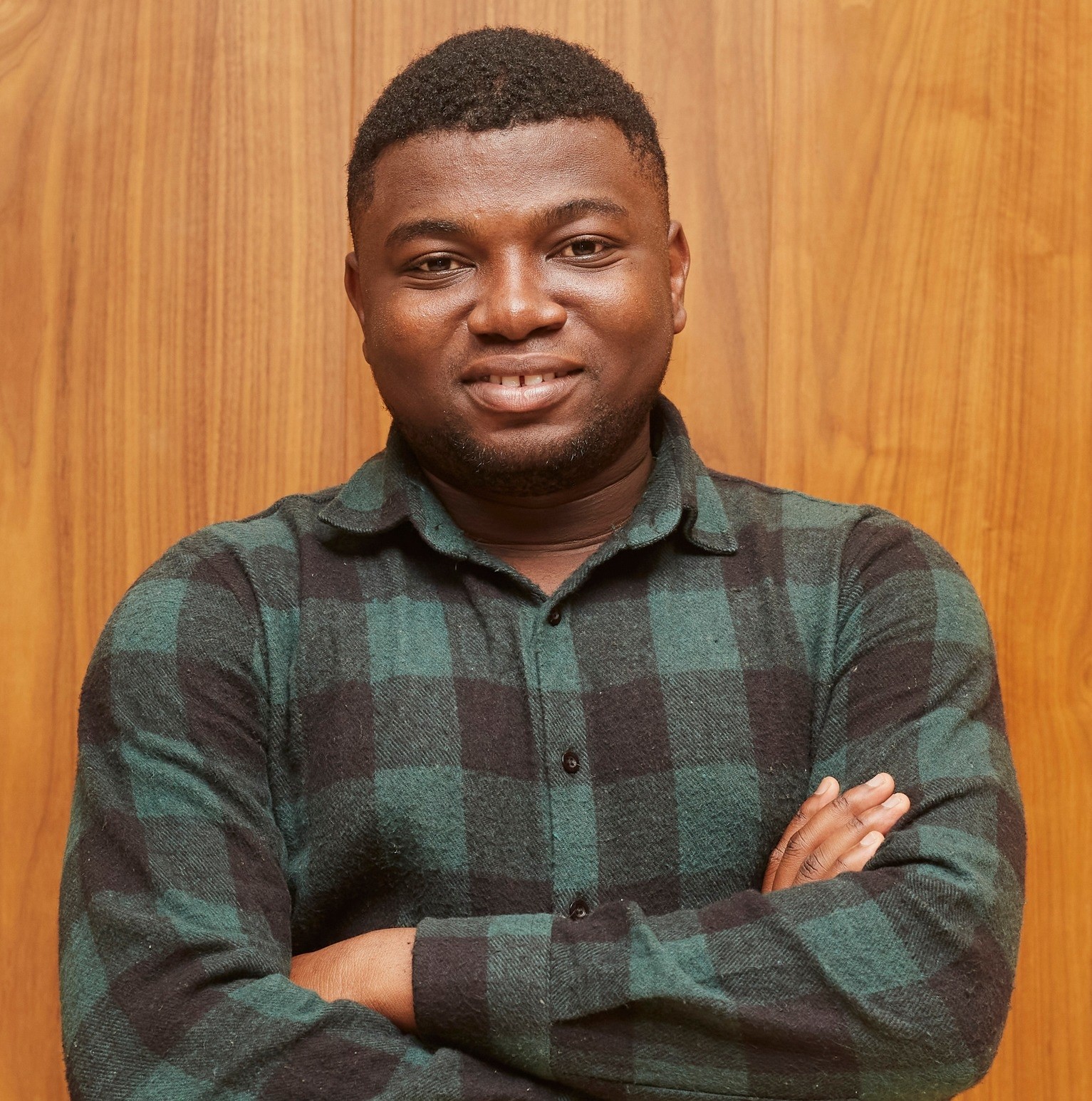L’histoire des peuples n’est jamais une ligne droite. Elle avance en spirales, en secousses, en ruptures.
À certains moments, tout semble figé. Le pouvoir en place paraît indéboulonnable. Les institutions tiennent, les élections passent, et pourtant… quelque chose gronde sous la surface.
Puis un jour, tout bascule.
Ce basculement n’arrive jamais par hasard. Il naît souvent d’un sentiment profond de trahison : les élites gouvernent pour elles-mêmes, la sécurité s’effondre, les jeunes ne voient plus d’avenir.
Alors, le peuple cesse de croire à ce qu’on lui a vendu : la démocratie, le marché libre, la croissance éternelle. Ces mots deviennent creux. Et les discours des puissants sonnent faux.
Dans ces périodes de doute, les imaginaires se réactivent.
On se tourne vers le passé, vers des figures comme Sankara, Nkrumah, Patrice Lumumba.
On rêve d’un modèle plus juste, plus souverain, plus enraciné dans nos réalités.
C’est souvent là que naissent de nouvelles idéologies, ou que d’anciennes idées reprennent vie :
le panafricanisme, l’auto-détermination, le socialisme africain…
Parfois même, c’est une foi religieuse ou technologique qui prend la relève, dans un désir d’ordre et de clarté.
Mais changer de modèle ne se fait pas sans tensions.
Il y a des luttes, des résistances, des confusions.
Ceux qui portent le changement ne sont pas toujours mieux que ceux qu’ils remplacent.
Et parfois, ce qu’on croyait être une libération devient une autre forme d’enfermement.
Car le plus dur n’est pas de renverser un système,
mais de bâtir un nouveau contrat social, qui tienne, qui inspire, qui soigne.
L’Afrique de l’Ouest est peut-être à ce tournant.
Ni tout à fait dans l’ancien monde, ni encore dans le nouveau.
Mais au cœur d’un moment historique où les peuples cherchent autre chose.
Et peut-être, cette fois, sauront-ils l’écrire ensemble.